
Orthopédie
Lombalgie chronique : faut-il essayer les médecines complémentaires ?Par Fanny Bernardon le 09/12/2019
Revue par le Pr Jérôme Allain, Chirurgien orthopédiste
Mise à jour le 19/03/2025
Notre colonne vertébrale est une charpente osseuse constituée de plusieurs vertèbres empilées les unes sur les autres. Chaque vertèbre est séparée de ses deux voisines (au-dessus et en dessous) par un disque intervertébral. Celui-ci est constitué d’un anneau fibreux et solide entourant un noyau liquidien souple et déformable. On peut comparer ces disques à des sortes de coussinets qui jouent le rôle d’amortisseur et qui absorbent les chocs entre les vertèbres. Grâce aux disques intervertébraux, les pressions que subit notre colonne sont réparties de façon optimale. Les disques confèrent ainsi à la colonne sa mobilité et sa flexibilité. C’est ainsi qu’elle parvient à assurer son rôle protecteur pour la moelle épinière et les racines nerveuses, tout en permettant à la fois la station débout avec un buste droit, mais aussi la mobilité indispensable à la vie.
Par définition, une discopathie désigne une pathologie du disque intervertébral. La discopathie dégénérative désigne le processus de vieillissement naturel du disque intervertébral au cours duquel il se déshydrate, se rigidifie et se tasse progressivement (le noyau discal est normalement constitué à 90 % d'eau). C’est un processus physiologique (beaucoup de tissus du corps humain ont tendance à se dessécher avec le temps comme la peau par exemple) mais survenant parfois de façon précoce ou trop intense. Cette évolution entraîne une perte de la capacité du disque à assurer son rôle d'amortisseur hydrique. De ce fait, les vertèbres subissent des contraintes anormalement élevées et entrent en conflit les unes avec les autres. C'est un peu comme si nous roulions avec une voiture dont un pneu est crevé. Nous aurons progressivement mal aux fesses à chaque relief du sol et risquerions la sortie de route dans les virages, à chaque accélération ou freinage. Ou encore, au lieu d'être assis sur un ballon tout neuf, nous l'étions sur un ballon dégonflé. Nos fesses toucheraient le sol et deviendraient rapidement douloureuses. C'est pourtant une des pathologies les plus fréquentes de la colonne vertébrale et la première cause d’invalidité chez l’adulte actif.
La discopathie peut survenir sur n’importe quel disque. On parlera de discopathie lombaire si elle affecte un disque intervertébral lombaire, ou de discopathie cervicale si le disque affecté se situe au niveau du rachis cervical. Le rachis dorsal est beaucoup plus rarement atteint car son rôle d’attache aux côtes le rend beaucoup moins mobile et il s’use donc moins. Le disque le plus fréquemment affecté est celui qui est placé entre les vertèbres L5 et S1 (à la jonction entre le rachis lombaire et le sacrum) car il est le plus bas situé et supporte donc tout le poids de la tête, des membres supérieurs et du tronc. Néanmoins, plusieurs disques peuvent être atteints en même temps.
Un deuxième avis est tout à fait pertinent dans le cadre d’une discopathie dégénérative dans la mesure où si cette pathologie peut se révéler invalidante pour les patients, y compris jeunes et actifs malgré les traitements conservateurs. L’indication opératoire reste facultative car les complications graves de la discopathie sont exceptionnelles. Lorsque le traitement médical ayant comporté différentes solutions médicamenteuses, une ou des infiltrations et la rééducation fonctionnelle n’apportent pas les résultats escomptés, se pose alors la question du traitement chirurgical. Mais d’autres possibilités existent : hypnose, thérapie cognitive, acupuncture... La décision de se faire opérer n’est jamais anodine et elle doit faire l’objet d’une discussion entre le patient, son chirurgien et son médecin traitant, voir son rhumatologue. La décision découle toujours d'une réflexion et d’une discussion multifactorielle, très liée à l'importance de la gêne fonctionnelle qui peut parfois être incompatible avec une qualité de vie quotidienne acceptable.
Par ailleurs, différentes techniques d'abord de la colonne (par derrière ou par devant) et plusieurs techniques chirurgicales sont possibles pour obtenir le résultat escompté. Le chirurgien doit toutes les maîtriser pour appliquer la solution la mieux adaptée à chaque cas qui reste toujours unique. Chacune possède ses propres avantages et inconvénients qui doivent être mis en balance et expliqués au futur opéré. D’autre part, l’opération ne signifie pas que la douleur disparaisse totalement. Elle n'exclut pas la nécessité, par la suite, de modifier ses habitudes (intoxication tabagique, surcharge pondérale...). Dans ce contexte, il convient donc de bien évaluer le rapport risques/bénéfices d’une opération avant de prendre sa décision et un deuxième avis peut vous apporter un éclairage supplémentaire sur les différents traitements qui existent mais aussi sur l‘opportunité d’une intervention chirurgicale dans votre cas. Une fois la décision prise, il faut encore déterminer le moment idéal pour passer à l’acte.
Ces choix difficiles nécessitent une bonne connaissance de sa maladie. Mieux informé, vous serez aussi mieux équipé pour participer aux choix thérapeutiques qui vous seront proposés.
Mais aussi toutes les autres questions spécifiques que vous vous posez.
Dans le cadre de la prise en charge d’une discopathie, plusieurs médecins sont susceptibles d’intervenir :
La discopathie se traduit généralement par des douleurs au niveau du bas du dos mais ce phénomène existe aussi dans les cervicales. Les deux symptômes les plus fréquents sont les douleurs rachidiennes (lombaires ou cervicales) avec souvent des irradiations fessières voir de réelles sciatiques pour les lombaires ou de réelles névralgies cervico-brachiales débutant dans les épaules pour les cervicales. Des irradiations vers l'occiput (appelée souvent névralgie d’Arnold) s’y associent souvent. Ces symptômes entraînent une raideur vertébrale, particulièrement en fin de journée, une fatigabilité, une perte d'autonomie physique et un épuisement psychologique.
La progression de la discopathie varie fortement d’un individu à l’autre et reste difficilement prévisible. Différents degrés d’évolution de modérée à sévère existent sans pouvoir aisément les prévoir.
En plus des douleurs occasionnées, l'évolution de la discopathie dégénérative présente le risque de voir se développer une ou plusieurs hernies discales (sortie d’un fragment de disque en dehors de son emplacement habituel, le plus souvent dans le canal rachidien) puisque celui-ci a perdu sa souplesse et se déchire plus facilement. Cela se traduit généralement par une compression des racines des nerfs innervant les membres source de sciatique, de cruralgie ou de névralgie cervico-brachiale (douleurs au niveau du cou et du membre supérieur secondaires à une atteinte de la racine d’un nerf). A un stade avancé, la discopathie peut également entraîner le développement d’une arthrose intervertébrale touchant les facettes articulaires postérieures qui sont emboîtées les unes au-dessus des autres comme les tuiles d'un toit. Leur télescopage lié au pincement du disque intervertébral augmente les contraintes mécaniques imposées à ces facettes articulaires et accélèrent leur vieillissement source d'arthrose.
Le diagnostic de discopathie se base tout d’abord sur un interrogatoire du médecin qui recherche notamment les symptômes et les facteurs de risque de la maladie. La discopathie survient le plus souvent sur un terrain génétique prédisposant (expliquant la fréquence des cas familiaux et les cas de survenue chez des sujets très jeunes), mais elle est très favorisée par certaines circonstances : le tabagisme avant tout, la surcharge pondérale voir l'obésité et les sollicitations mécaniques anormales (comme le fait de porter de lourdes charges ou de faire des mouvements traumatisants répétitifs mais aussi une déformation de la colonne vertébrale comme la scoliose).
Des examens d’imagerie de première intention sont prescrits afin d’établir le diagnostic :
Le choix du traitement d'une discopathie dépend :
Le but du traitement est bien entendu avant tout de soulager les douleurs. Dans un premier temps, le médecin traitant prescrit des médicaments antalgiques et/ou anti-inflammatoires parfois associés à des myorelaxants qui réduisent les contractures des muscles de la colonne. Une consultation auprès d’un rhumatologue est utile en cas d’efficacité insuffisante du premier traitement. Celle auprès d’un algologue (médecin de la douleur) permet d’optimiser le traitement antalgique qui peut reposer sur de multiples solutions médicamenteuses ou non. La réalisation de séances de rééducation par un kinésithérapeute est souvent utile pour soulager les douleurs et assouplir le rachis. L’efficacité de l'ostéopathie dans la lombalgie reste très discutée et de nombreuses publications scientifiques ont largement remis en cause son intérêt thérapeutique dans cette population. L’évaluation de celle de la chiropraxie ne repose pas sur suffisamment d’études validées par des comités d’experts.
A l’inverse, le recours à une psychothérapie type PRT (Pain Reprocessing Therapie) a démontré son efficacité, y compris durablement, chez les lombalgiques chroniques. Parallèlement l’intérêt de plusieurs pratiques comme le yoga, le qigong ou le Pilates ont été validées par des études cliniques médicales.
Des infiltrations d'anti-inflammatoires puissants (corticoïdes) sont proposées en cas de résistance des douleurs à ces traitements. Leur efficacité dans le temps reste très discutée mais elles permettent le plus souvent de traiter une poussée douloureuse pour revenir à une gêne fonctionnelle acceptable. D’autres produits sont parfois utilisés pour les infiltrations : ozone ou PRP principalement. Le mode de fonctionnement de la PRP repose principalement sur la libération de protéines qu’elle entraîne et qui contribuent à la cicatrisation des tissus lésés. Par ailleurs, les facteurs de croissance libérés par les plaquettes luttent contre l'inflammation locale.
L'ozonothérapie discale consiste à introduire dans le disque lui-même de l'ozone gazeux. Cela a pour effet de rétrécir la matière à l’intérieur du disque avec en particulier une augmentation de sa déshydratation et donc à y diminuer la pression excessive, soulageant ainsi la douleur. Elle réduit par ailleurs l'inflammation grâce à ses fortes propriétés oxydantes. On comprend néanmoins qu’elle ne vise aucunement à rétablir un disque normal mais au contraire à accélérer sa déshydratation. La littérature sur les résultats de cette thérapie reste insuffisante.
Dans tous les cas, une prise en charge multidisciplinaire dans une école du dos ou centre de RFR (Restauration Fonctionnelle du Rachis), encadrée par des médecins de médecine physique et réadaptation est fortement conseillée avant d'envisager une éventuelle solution chirurgicale.
Les traitements chirurgicaux sont réservés aux formes sévères de discopathie très invalidantes après échec des traitements conservateurs décrits ci-dessus. Plusieurs techniques coexistent, l'arthroplastie discale est une intervention qui consiste à remplacer le disque lésé par une prothèse de disque. Cette opération permet d'interposer entre les vertèbres un implant remplaçant le disque pathologique, de rétablir la hauteur intervertébrale et de maintenir la mobilité de l'étage opéré pour réduire la douleur et éviter que les étages discaux adjacents ne se dégradent rapidement. Elle est indiquée chez les patients actifs qui ne présentent pas de pathologie associée (artérite en particulier).
La deuxième solution chirurgicale consiste à pratiquer une arthrodèse, c’est-à-dire à obtenir la fusion (soudure) définitive entre les deux vertèbres. C’est possible en créant des ponts osseux reliant les deux vertèbres, grâce à une greffe osseuse et en immobilisant les vertèbres. Celles-ci ne ne doivent en effet plus bouger pendant tout le temps que la greffe prenne (comme quand il faut tenir deux bâtons de bois bien immobiles pendant que leur collage se réalise). Mais cette greffe met 3 à 12 mois pour créer ces ponts entre les vertèbres ! Il faut donc les immobiliser avec des implants (vis, cages, tiges ou plaques). C’est ce qu’on appelle l’ostéosynthèse. Cette intervention a pour but de faire disparaître tout mouvement du disque pathologique et ainsi à supprimer le conflit entre les vertèbres situées de part et d'autre du disque malade pour soulager les douleurs.
La neurostimulation vise à empêcher les fibres nerveuses situées dans le canal rachidien à transmettre au cerveau l’information douleur. Si cette technique a largement démontré son efficacité sur les douleurs dites neuropathiques, survenant le plus souvent après une intervention chirurgicale ayant lésé les racines nerveuses, son efficacité sur la lombalgie semble modeste, sauf peut-être chez certains patients préalablement opérés.
A noter que les implants inter-épineux (coussinets souples interposés entre les apophyses épineuses postérieures) parfois proposés n’ont jamais fait la preuve de leur efficacité dans la discopathie dégénérative et ne doivent donc pas être utilisés dans cette pathologie.
Nous savons aujourd'hui que l'origine de la discopathie dégénérative est liée à un défaut d'hydratation du noyau discal. Celui-ci est principalement lié à un défaut en qualité et/ou en quantité d’une protéine spécifique, appelée protéoglycane. Cette protéine agit comme une éponge en aspirant et en maintenant les molécules d’eau à l’intérieur des noyaux discaux. Elle est fabriquée par certaines cellules du disque appelé chondrocytes like. Chez certains individus la concentration de ces cellules est insuffisante. Chez d'autres, c'est la protéine fabriquée qui est de mauvaise qualité, ne jouant pas son rôle efficacement. Tout ceci est essentiellement d’origine génétique (la génétique est considérée comme le facteur essentiel de la dégradation discale, estimé responsable de 70% des cas). Ces constatations ont abouti à différentes tentatives thérapeutiques aujourd'hui appliquées dans plusieurs études chez l'homme. On les regroupe sous le terme de thérapies régénératives. Certaines consistent à prélever des cellules souches pour les injecter dans le disque afin de se transformer en chondrocytes like et restaurer ainsi une concentration suffisante de protéoglycane de bonne qualité. D'autres ont pour but de stimuler la multiplication des cellules chondrocytes like à l'intérieur du disque par des produits anabolisants. Nul doute que les thérapies génétiques parviendront dans l’avenir à corriger les anomalies du génome et à restaurer ainsi une bonne hydratation des disques.

Chirurgien orthopédiste
Clinique Geoffroy Saint-Hilaire (Ramsay)

Neurochirurgien
CHRU Tours - Hôpital de Bretonneau

Chirurgien orthopédiste
Clinique Geoffroy Saint-Hilaire (Ramsay)
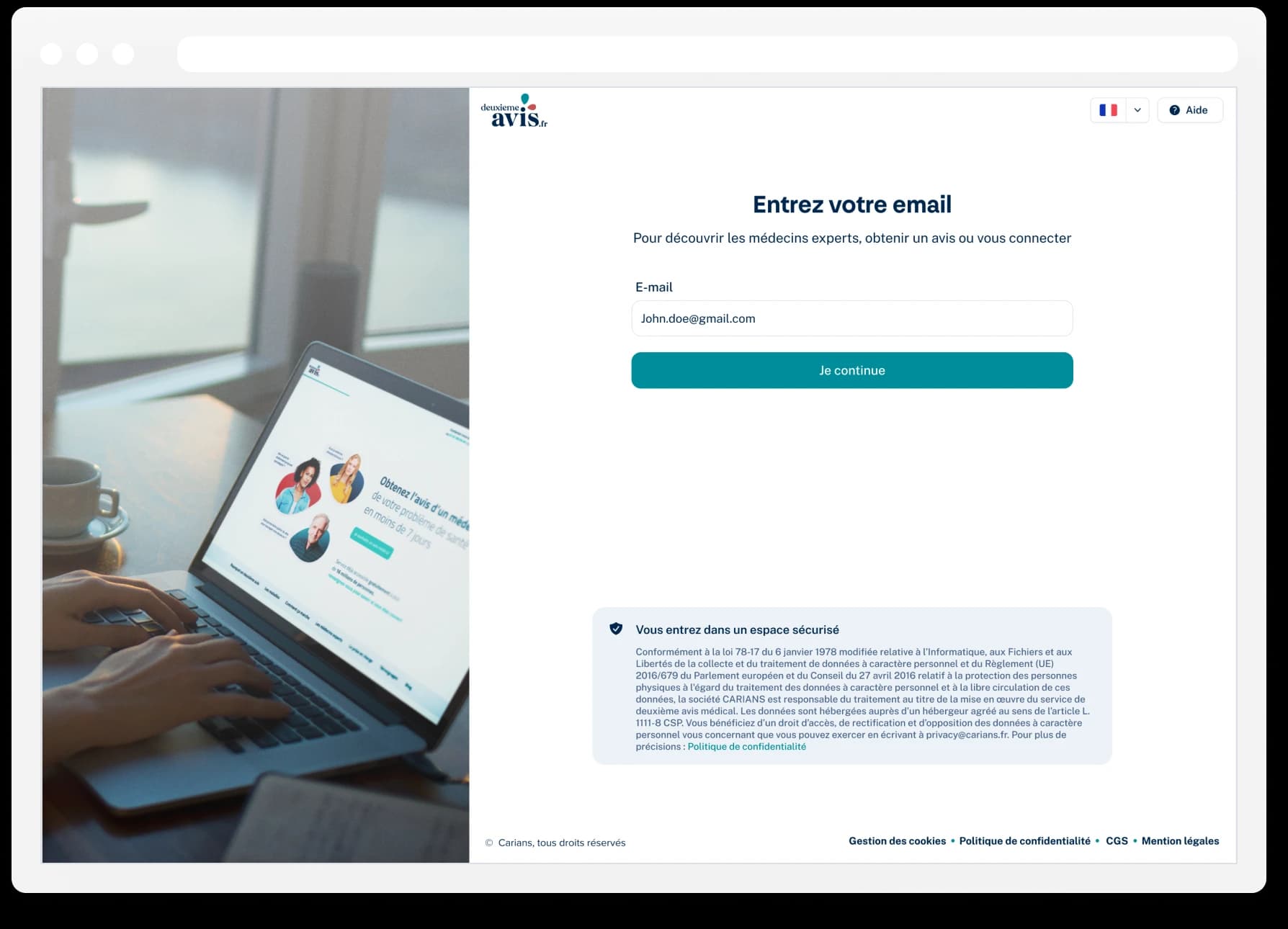

Témoignages
L'histoire d'Odile, 55 ans, en invalidité professionnelle à cause d'une discopathiePar Hortense Fisset le 17/06/2024
Site parfait pour prendre une décision médicale en toute Indépendance. Réponse rapide et professionnelle. Je recommande
Fred
Très bon accueil, très bonne écoute, les conseils donnés ont ouvert des possibilités de prise en charge intéressantes, merci beaucoup.
Denis

Orthopédie
Anti douleurs, corset, attelle, rééducation… les traitements non chirurgicaux en orthopédiePar Fanny Bernardon le 16/12/2019

Orthopédie
Lombalgie chronique : faut-il essayer les médecines complémentaires ?Par Fanny Bernardon le 09/12/2019

Orthopédie
3 manières d’éviter ou de retarder une chirurgie orthopédiquePar Fanny Bernardon le 18/02/2025

Orthopédie
Zoom sur le médecin de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR)Par Fanny Bernardon le 05/02/2025
