
Orthopédie
Lombalgie chronique : faut-il essayer les médecines complémentaires ?Par Fanny Bernardon le 09/12/2019
L’humérus est un os long situé dans le bras. Il s’articule :
Il est constitué d’une diaphyse (partie longue) et de 2 épiphyses (les 2 bouts à chaque extrémité de la diaphyse).
Une fracture de l’humérus peut survenir :
Un deuxième avis est tout à fait pertinent dans le cadre d’une fracture de l’humérus. En effet, si les fractures simples sont le plus souvent traitées orthopédiquement (c'est-à-dire une immobilisation sans opération), la prise en charge des cas complexes ne fait pas toujours consensus. Différentes techniques chirurgicales existent, dépendant de la situation unique de chaque patient. Elles méritent d’être soigneusement exposées. Certaines complications de ces techniques chirurgicales ne sont pas exclues : lésion du nerf radial (qui paralyse les muscles extenseurs du poignet et de la main), pseudarthrose (absence de consolidation de la fracture) ou encore algodystrophie. La coopération du patient lors de la rééducation est essentielle. Dans ce contexte, un deuxième avis permet d’apporter un nouvel éclairage afin de choisir le traitement le plus adapté au tableau médical de chaque patient.
Mais aussi toutes les autres questions spécifiques que vous vous posez.
Un chirurgien orthopédiste. Il est spécialiste des pathologies de l’appareil locomoteur (os, muscles, tendons, articulations, ligaments). Il doit être spécialiste des membres supérieurs et pratiquer la traumatologie.
Les symptômes sont :
Le diagnostic requiert :
Les fractures de la diaphyse de l’humérus représentent 3 % de toutes les fractures. Elles surviennent chez des adultes de tout âge suite à un choc violent comme un coup, une chute sur le coude ou le poignet ou encore un accident de la voie publique. Elle peut survenir par torsion après un “bras de fer”. Leur incidence augmente avec l’âge. Chez les personnes âgées, la diaphyse humérale peut se fracturer même en cas de simple chute à cause de l’ostéoporose (maladie de l’os entraînant sa fragilité). Une métastase osseuse (tumeur dans l’os) peut également entraîner une fracture.
La prise en charge dépend de la localisation de la fracture, de sa gravité, de la direction du trait de la fracture, du nombre et de la taille des fragments osseux et de la présence de lésions nerveuses, vasculaires ou cutanées associées. Des médicaments anti-inflammatoires (en l’absence de contre indication) et des antalgiques permettent de lutter contre la douleur. Les complications principales de ces fractures sont la paralysie du nerf radial et une pseudarthrose qui peuvent nécessiter une opération chirurgicale complexe. Si la fracture est mal réduite, un trouble de rotation peut apparaître qui peut compromettre la mobilité de l’épaule.
Le traitement orthopédique (ou conservateur) : il s’agit de repositionner puis d’immobiliser les articulations et le bras par un plâtre ou une attelle dans la position appelée « coude au corps ». L’articulation de l’épaule ne doit pas être mobilisée activement pendant 4 à 6 semaines et le système d’immobilisation est retiré uniquement lorsque la fracture est complètement consolidée, ce qui parfois peut prendre 3 mois. Une rééducation avec un kinésithérapeute peut alors commencer. Il est important que le plâtre soit parfaitement adapté à la forme du bras pour obtenir un bon résultat, c'est-à-dire éviter une trouble de rotation de l’épaule.
Le traitement chirurgical : il est indiqué dans les fractures très déplacées, pathologiques (métastase osseuse, ostéoporose), chez les patients ne souhaitant pas être immobilisés, présentant des lésions vasculaires ou nerveuses ou chez qui le traitement orthopédique n’a pas fonctionné. Les fractures ouvertes constituent une urgence chirurgicale en raison du risque d’infection. Différentes techniques d’ostéosynthèse existent, c’est-à-dire visant à maintenir l’alignement de fragments osseux grâce à du matériel : par enclouage (la moins invasive), par plaque, c’est la méthode utilisée en cas de paralysie radiale pour vérifier si le nerf est simplement contus ou bien s’il est sectionné, ou par fixateur externe : on réserve généralement cette méthode aux fractures ouvertes en attendant de pouvoir utiliser une autre technique. Il faut éviter les fixateurs externes car leur taux d’infection est plus grand que les autres techniques (parfois on n’a pas le choix que de les employer).
Le membre supérieur peut être immobilisé jusqu’à 3 mois, à l’issue desquels le patient suivra une rééducation avec un kinésithérapeute.
Les principales séquelles d’une fracture de l’humérus sont :
La prise en charge d’une lésion du nerf radial ou d’une pseudarthrose est chirurgicale.
La prise en charge dépend :
Mise à jour le 23/08/2024 Revue par le Professeur Philippe Liverneaux
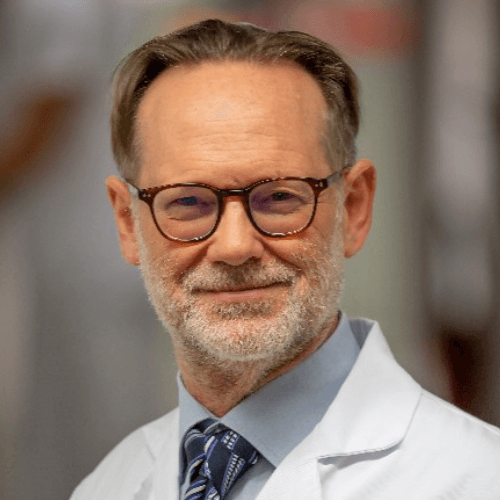
Chirurgien orthopédiste
CHU Strasbourg - Hôpital de Hautepierre
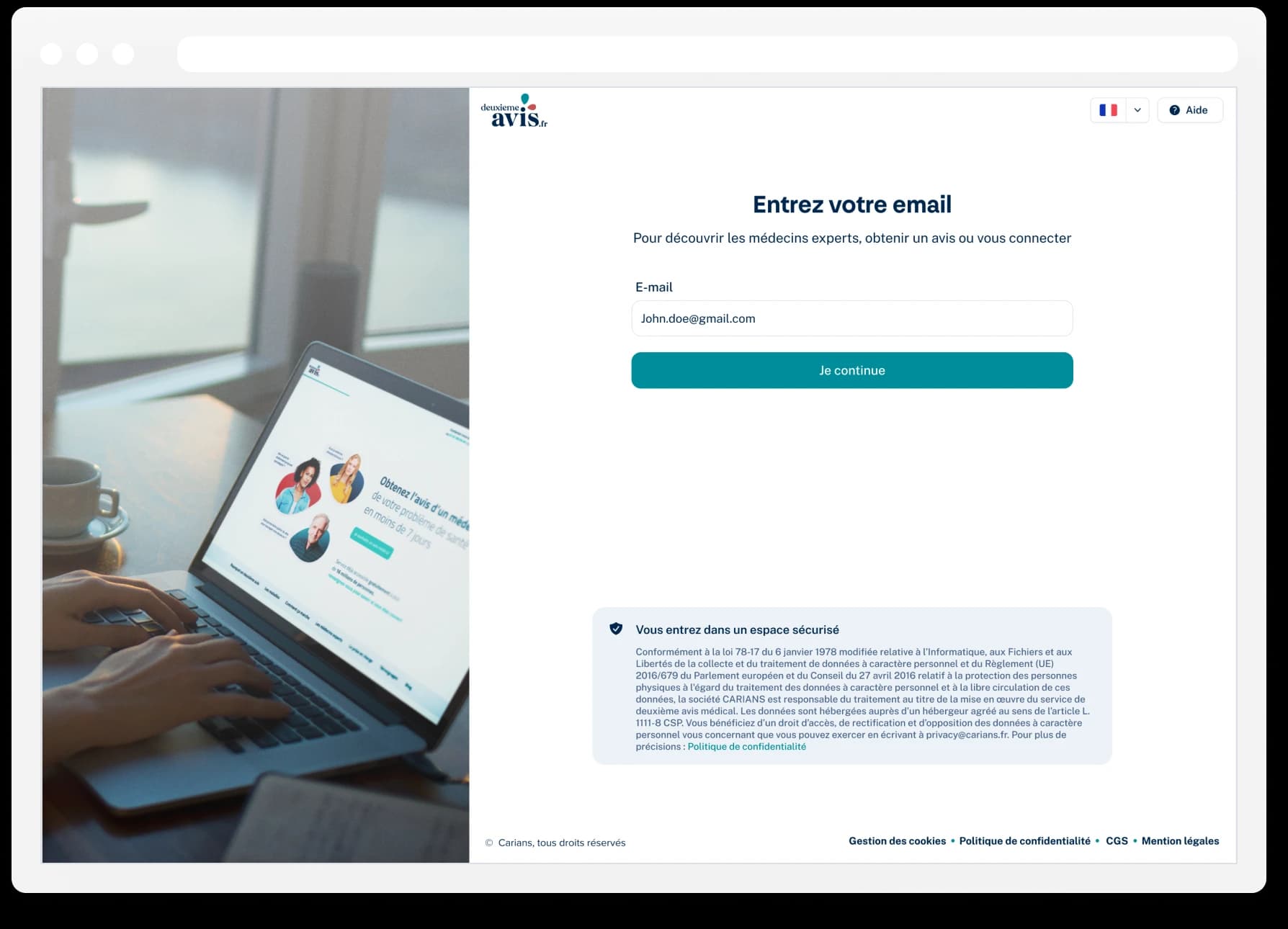

Témoignages
L'histoire de Raphaël, 29 ans, atteint d’une fracture de l’humérusPar Hortense Fisset le 06/11/2023
Site parfait pour prendre une décision médicale en toute Indépendance. Réponse rapide et professionnelle. Je recommande
Fred
Très bon accueil, très bonne écoute, les conseils donnés ont ouvert des possibilités de prise en charge intéressantes, merci beaucoup.
Denis

Orthopédie
Anti douleurs, corset, attelle, rééducation… les traitements non chirurgicaux en orthopédiePar Fanny Bernardon le 16/12/2019

Orthopédie
Lombalgie chronique : faut-il essayer les médecines complémentaires ?Par Fanny Bernardon le 09/12/2019

Orthopédie
3 manières d’éviter ou de retarder une chirurgie orthopédiquePar Fanny Bernardon le 18/02/2025

Orthopédie
Zoom sur le médecin de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR)Par Fanny Bernardon le 05/02/2025
