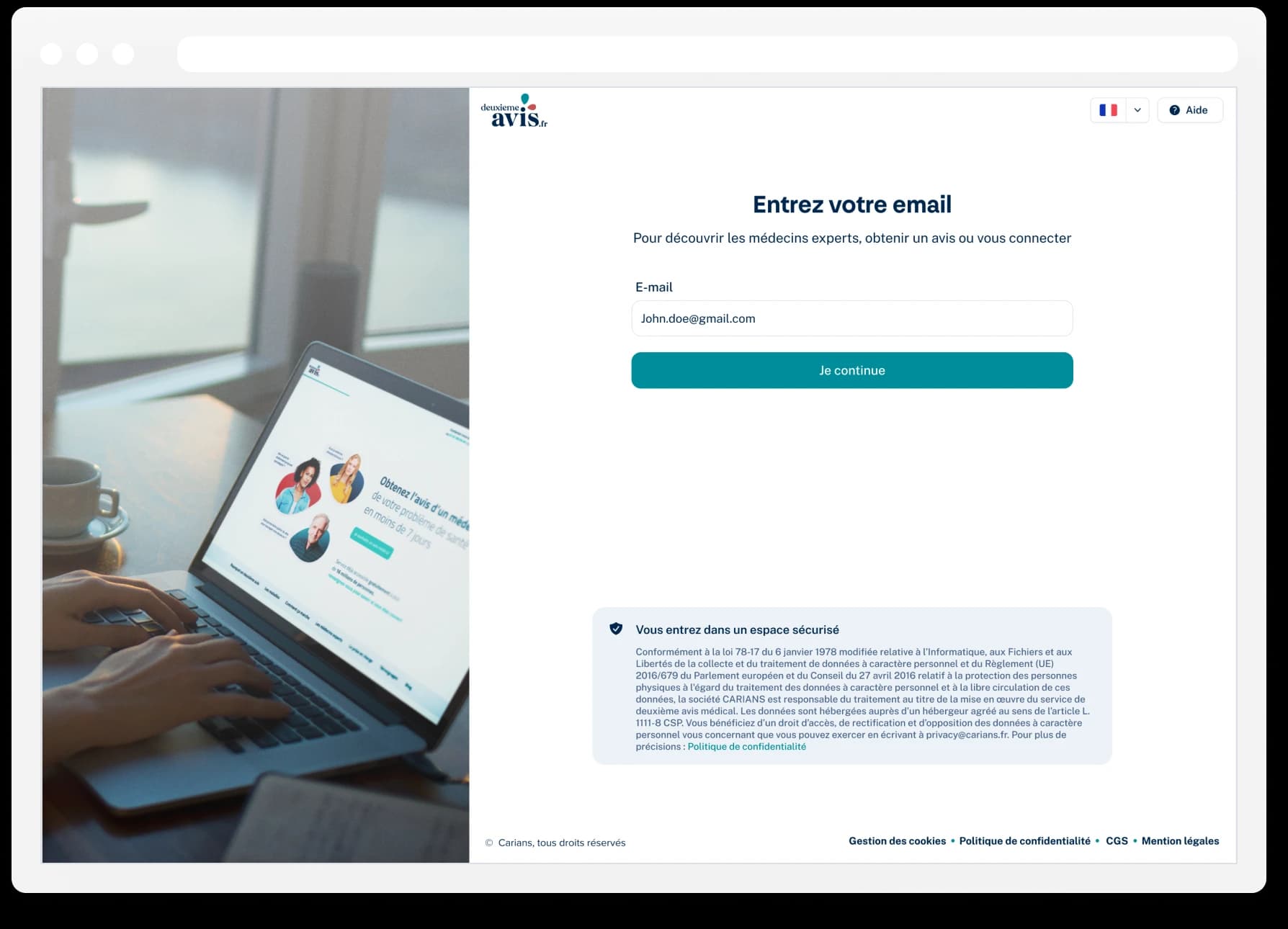Le
choix du traitement dépend :
- Du type de vessie neurologique dont souffre le patient.
- Des symptômes qu’il présente (incontinence, rétention…).
- Des complications de la vessie neurologique qu’il présente ou des facteurs de risques de complications.
- Des circonstances d’apparition de la vessie neurologique.
- De son évolution.
- Des troubles éventuellement associés.
- De l’âge du patient.
- De ses antécédents familiaux et médicaux.
- De son état de santé général.
- De ses choix.
L’objectif du traitement de la
vessie neurologique diffère en fonction des situations. Mais d’une manière générale, le but est de soulager les symptômes, d’améliorer la qualité de vie, et bien sûr de prévenir les complications.
Selon les cas, le traitement vise à
assurer la continence urinaire (c’est-à-dire de réduire au maximum les fuites urinaires) ou, dans le cas inverse d’une rétention urinaire, il a pour but de
diminuer la pression de la vessie et de prévenir les risques d’infection urinaire. Il faut en effet à tout prix
préserver la fonction rénale en évitant les complications qui pourraient survenir à long terme.
Pour traiter l’
hyperactivité vésicale, les médecins prescrivent des
anticholinergiques, médicaments qui relaxent la vessie, et donc augmentent sa capacité. Ces médicaments font disparaître les fuites urinaires et diminuent la pression vésicale ce qui évite que la vessie se déforme et que les reins se dilatent.
La
rééducation périnéo-sphinctérienne est également parfois proposée, quand la lésion neurologique le permet.
Des
injections de toxine botuliques dans la paroi de la vessie sont jugées très efficaces. Ces injections entraînent une paralysie du muscle vésicale pendant 7 à 10 mois. Cela supprime du même coup les contractions anarchiques et le patient peut alors vider sa vessie par auto-sondage. Quand l’effet s’arrête, il faut renouveler l’injection.
En dernier recours, la
chirurgie peut apporter une solution quand le traitement médical échoue. Différentes techniques existent. Le chirurgien peut décider d’agrandir la vessie à partir d’un morceau d’intestin grêle. Il peut également stimuler la vessie en plaçant des électrodes à certains endroits, sur la moelle épinière ou sur les racines nerveuses.
Dans les cas de rétention chronique, le traitement de référence est l’
auto-sondage. Cette technique permet au patient de vider sa vessie lui-même, plusieurs fois par jour. Les sondes sont de plus en plus évoluées et donc mieux tolérées.
Dans les cas de troubles du sphincter, en plus de l’auto-sondage, le médecin peut également prescrire des
alphabloquants pour diminuer la résistance de l’urètre, ou encore des
injections de toxine botulique.
Lorsque le sphincter est en cause, des
séances de rééducation permettent de renforcer le muscle. Cette réduction est souvent associée à des médicaments pour augmenter le tonus de l’urètre, ou augmenter la capacité de contraction du sphincter.