
Gastro-entérologie
Troubles digestifs : face à quels symptômes consulter ?Par Fanny Bernardon le 29/03/2021
La fissure anale est la deuxième pathologie proctologique en France. Elle touche autant les hommes que les femmes. Sa prévalence est plus élevée chez les patients jeunes (tranche d’âge entre 30 et 40 ans).
Le principal facteur de risque de la fissure anale est la présence de troubles du transit, en particulier la constipation et les efforts de poussée inadéquats.
La fissure anale dite « idiopathique » se caractérise par une déchirure superficielle de la peau qui recouvre l’anus. Elle est à différencier d’autres déchirures comme les ulcérations anales de la maladie de Crohn, les lésions traumatiques, les tumeurs, les ulcérations de la maladie de Behcet, etc.
Un avis médical est donc indispensable pour confirmer le diagnostic.
L’aspect de la fissure anale peut évoluer à cause d’une inflammation ou d’une infection.
En phase aiguë, la limite de la lésion est fine et nette. Puis la bordure s’épaissit en phase chronique pour former une marisque aux limites fibreuses, c’est-à-dire un repli de la peau plus ou moins volumineux. La fissure chronique peut s’accompagner dans sa partie interne d’une papille (repli fibreux de la muqueuse semblable à celui de la peau) qui peut gêner et se prolabler (sortir de l’anus) à chaque selle participant au maintien de la fissure. Lorsque la fissure s’infecte, il est possible de voir un orifice externe fistuleux adjacent purulent.
La fissure anale est le plus souvent localisée dans la partie postérieure de l’anus (70-90 % des cas), sauf dans le postpartum où la localisation est davantage antérieure. Ceci nous amène à la physiopathologie de cette pathologie. Le point de départ habituel est le passage traumatique d’une selle dans un canal anal qui manque de souplesse avec création d’une plaie. La douleur de cette plaie est responsable d’une réaction à type de spasme douloureux du muscle de l’anus (sphincter) chez des patients possiblement prédisposés. Le muscle est plus épais dans la partie postérieure de l’anus, ce qui explique la localisation fréquente à ce niveau. Ce spasme ou contracture réflexe est responsable d’une compression des micro-vaisseaux traversant le sphincter pour irriguer la muqueuse anale d’où le retard de cicatrisation. La fissure anale peut donc être considérée comme une plaie ischémique. Dans le postpartum, ce côté spasmodique est moins retrouvé et la fissure anale est probablement en partie liée au traumatisme du passage d’une selle sur un périnée ischémique fragilisé par un accouchement long et difficile.
La fissure anale peut entraîner un inconfort voire une grande douleur quotidienne et donc dégrader la qualité de vie. Les traitements médicamenteux et chirurgicaux sont variés. Ils dépendent des symptômes et du caractère aigu ou chronique de la fissure. Les différentes options méritent d’être étudiées attentivement, notamment si une intervention chirurgicale est nécessaire. Dans ce contexte, un deuxième avis permet de faire le diagnostic rapidement pour proposer une prise en charge médicale ayant davantage de chance de succès quand elle est précoce, permet d’éliminer d’autres diagnostics différentiels fréquents, permet d’apporter un éclairage supplémentaire sur les méthodes thérapeutiques en particulier chirurgicales adaptées à son cas et rassurer par rapport au risque d’incontinence anale. Mieux informé, le patient peut prendre une part active dans l’élaboration de sa stratégie thérapeutique. De son adhésion dépendra le succès de cette dernière.
Mais aussi toutes les autres questions spécifiques que vous vous posez.
Les spécialistes à consulter sont :
Les symptômes sont :
L’appréhension de la selle, la douleur post-défécatoire persistante de plusieurs heures et les saignements à l’essuyage sont des signes quasi-pathognomoniques d’une fissure anale. Cette appréhension aggrave souvent une constipation préexistante et les patients se retrouvent souvent dans un cercle vicieux avec parfois des fécalomes douloureux et difficiles à évacuer.
Lorsque la fissure n’est pas traitée et au-delà de 6 à 8 semaines, elle devient chronique. Les patients peuvent se plaindre alors d’une boule anale considérée souvent comme une hémorroïde (la marisque).
Lorsque la fissure s’infecte, les douleurs typiques fissuraires deviennent moins au premier plan et les patients se plaignent d’épisodes douloureux récidivants d’abcès (collections de pus) ou de fistule chronique avec des suintements et des démangeaisons.
Le diagnostic requiert :
Le choix du traitement dépend :
La prise en charge médicale d’une fissure anale repose sur :
Il faudra noter que le traitement médical est beaucoup plus efficace dans le cas des fissures aiguës et l’efficacité chute à moins de 50 % dans les fissures chroniques. D’où l’intérêt d’un diagnostic et d’une prise en charge optimale d’emblée.
Nous avons recours à la chirurgie en cas de fissure anale aiguë hyper-douloureuse empêchant toute prise en charge médicale, en cas de fissure anale chronique en échec d’un traitement médical bien conduit pendant au moins 8 semaines, en cas de récidive ou en cas de fissure infectée d’emblée.
Globalement, il existe deux méthodes d’intervention chirurgicale en cas de fissure anale non infectée :
En France, la technique la plus pratiquée est la fissurectomie alors que la sphinctérotomie reste le standard du traitement chirurgical de la fissure anale dans la grande majorité des autres pays du monde.
Le traitement d’une fissure anale infectée rejoint celui de la fistule anale et peut se faire en un ou deux temps opératoires selon la hauteur du sphincter enjambée par le trajet fistuleux. La prise en charge d’une fissure anale infectée est plus complexe qu’une fissure anale simple.
Mise à jour le 14/01/2025 Revue par le Docteur Nadia Fathallah
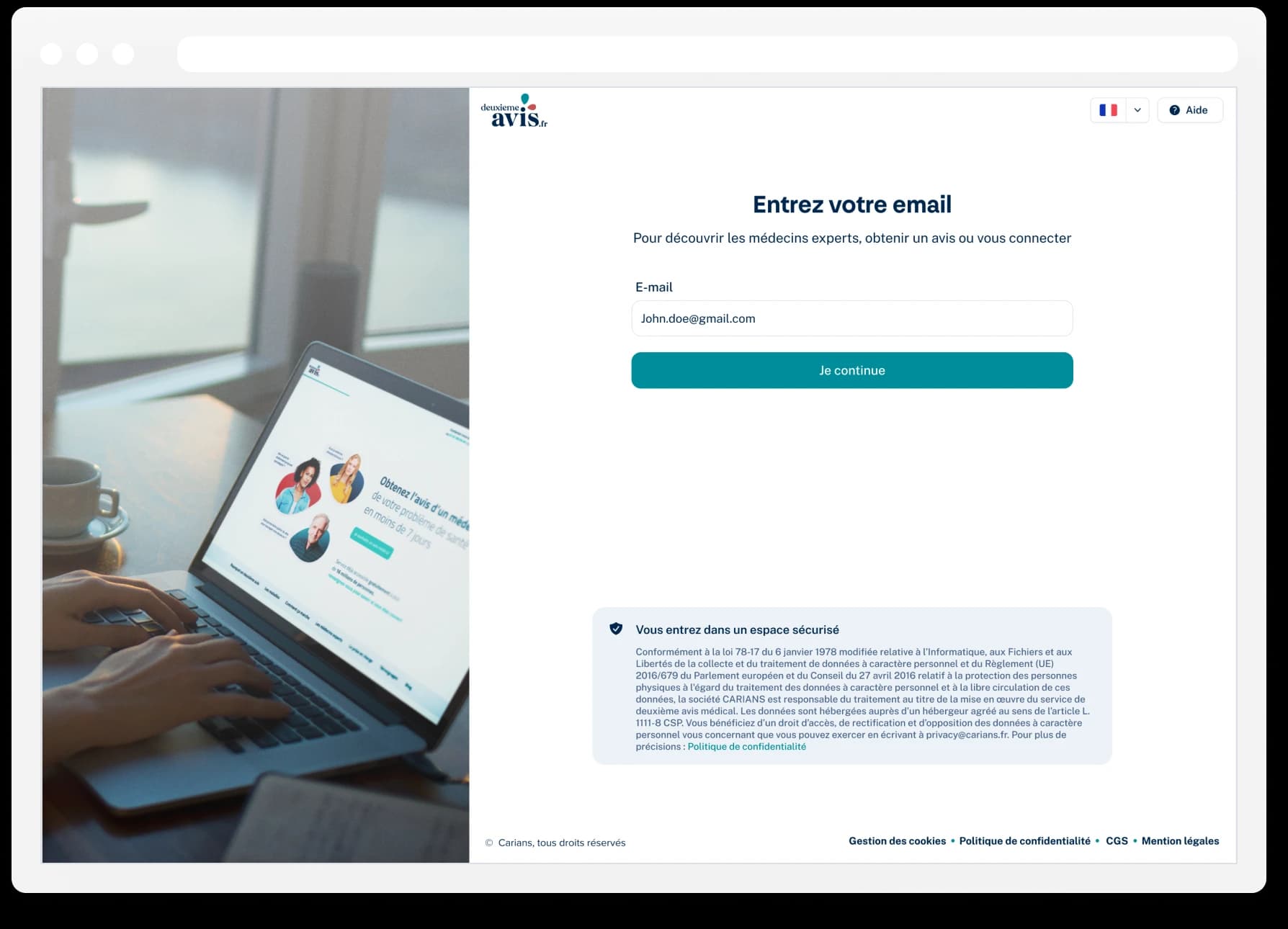

Gastro-entérologie
Troubles digestifs : face à quels symptômes consulter ?Par Fanny Bernardon le 29/03/2021


Relecture d'imagerie médicale
Qu'est-ce qu'une IRM cérébrale anormale ?Par Pascaline Olivier le 24/03/2025
