
Relecture d'imagerie médicale
Qu'est-ce qu'une IRM cérébrale anormale ?Par Pascaline Olivier le 24/03/2025
Dans le cadre d’une myélofibrose primitive, l’accès à un deuxième avis peut se révéler particulièrement pertinent. En effet, la myélofibrose primitive est une maladie qui peut engager le pronostic vital du patient et les traitements doivent être choisis et maniés avec précaution. Certaines décisions (proposer une chimiothérapie, utiliser les nouveaux médicaments ciblés, faire une splénectomie ou entreprendre une greffe de cellules souches par exemple) doivent être soigneusement pesées avant d’être prises. Dans ce contexte, un deuxième avis peut vous permettre de participer sereinement aux options thérapeutiques, de manière lucide éclairée et en toute connaissance des risques encourus.
Mais aussi toutes les autres questions spécifiques que vous vous posez.
L'onco-hématologue est le spécialiste des maladies et des cancers du sang et de la moelle osseuse.
Le diagnostic de leucémie myéloïde chronique est le plus souvent fortuit suite à la constatation d'anomalies évocatrices à l'hémogramme réalisé de manière systématique.
Parfois c'est l'association de certains symptômes qui conduit le médecin à demander des examens complémentaires spécifiques.
Dans le but de confirmer le diagnostic, d'éliminer une leucémie myéloïde chronique en phase accélérée ou acutisée, d'écarter certains diagnostics différentiels et enfin à titre préthérapeutique et pronostic, le médecin pourra demander certains examens :
Le choix du traitement de la myélofibrose dépend :
Il n’existe pas réellement de médicament permettant de guérir la myélofibrose, mais certains nouveaux médicaments semblent apporter un espoir. Le traitement vise plutôt à diminuer les symptômes et à préserver la qualité de vie du patient. Il n’est prescrit que lorsque les symptômes ou les complications apparaissent.
En première intention, le traitement repose sur une chimiothérapie par voie orale, généralement à base d’hydroxyuré. Cette chimiothérapie a pour but de réduire la production excessive des cellules de la rate qui sont à l’origine des troubles tout en faisant attention car la rate joue un rôle important dans la fabrication des globules sanguines.
Le médecin prescrit également des médicaments pour améliorer l’anémie du patient. Ce sont par exemple les corticoïdes, les androgènes, ou encore des médicaments qui ont pour objectif d'augmenter la production de globules rouges.
Lorsque l’anémie ne répond pas aux médicaments, le médecin envisage généralement de recourir à des transfusions sanguines tout en sachant qu’elles sont moins efficaces car le volume du sang est augmenté par le volume de la rate et la transfusion est donc dilué. Lorsque la rate est très volumineuse et gênante, il faut parfois envisager son ablation lors d’une opération chirurgicale (splénectomie). Mais l’ablation de la rate supprime une grande partie de la fabrication des globules et donc son indication est rare et doit être prudente.
La greffe de cellules souches est actuellement le seul traitement permettant de guérir la maladie. Elle nécessite toutefois de trouver un donneur compatible. C’est un traitement lourd qui peut entraîner des risques de complications. C’est pourquoi elle n’est proposée qu’à une minorité de patients. Ceux-ci doivent être jeunes et présenter une forme évolutive de la maladie.
Plus récemment, les médecins ont constaté que les anti-JAK2 (des médicaments ciblés qui freinent l’action de la protéine JAK2 et qui appartient à la classe des inhibiteurs de tyrosine-kinase) peuvent apporter des résultats. Le JAKAVI® notamment proposé depuis 2012, permet dans certains cas une diminution du volume de la rate et une reprise du poids. Mais sa tolérance est assez aléatoire. Ce médicament n’est proposé qu’aux patients qui ne sont pas éligibles à la greffe de cellules souche. La recherche se poursuit dans ce domaine.
Ajoutée le 12/12/2023
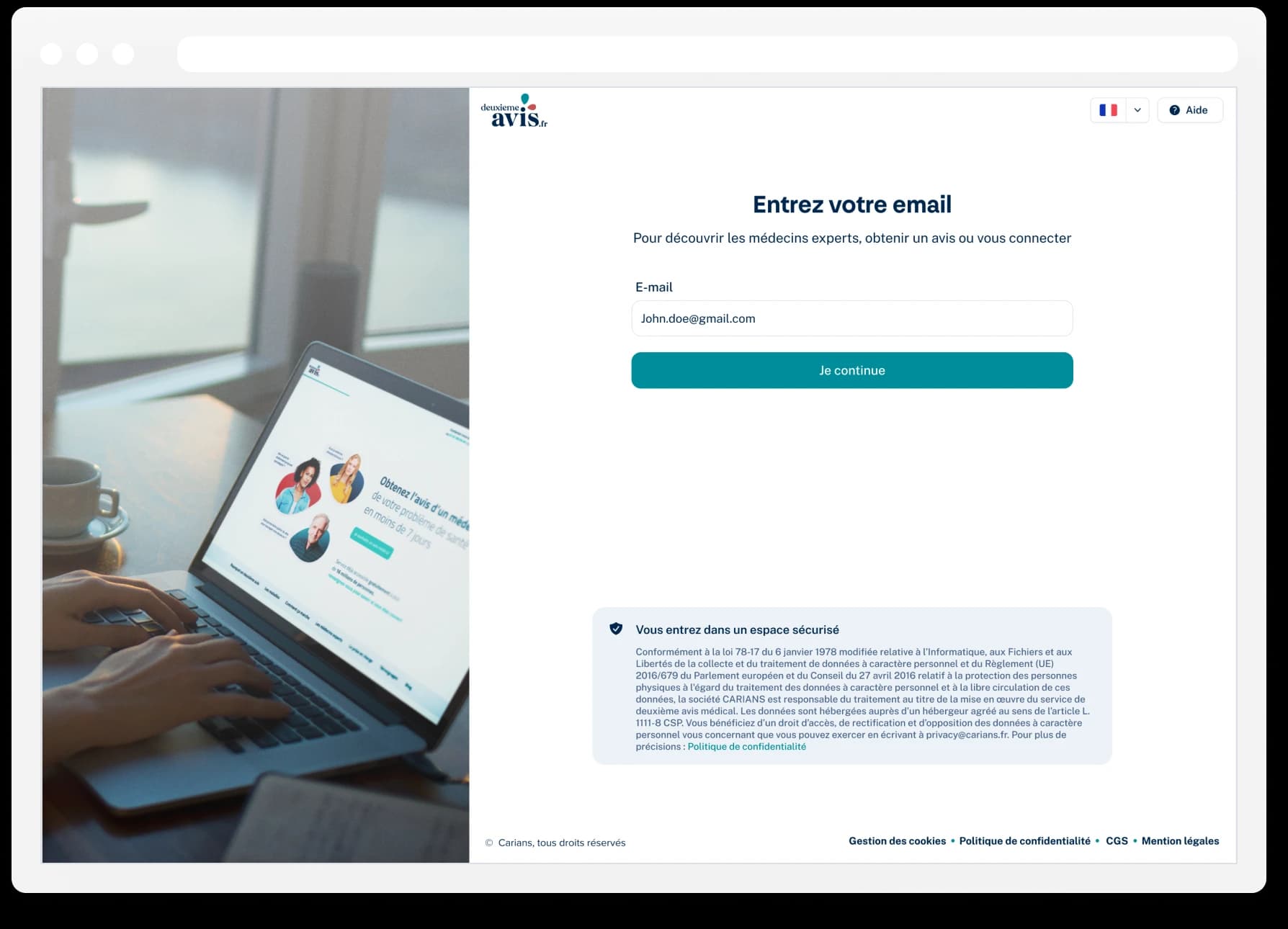

Relecture d'imagerie médicale
Qu'est-ce qu'une IRM cérébrale anormale ?Par Pascaline Olivier le 24/03/2025


Orientation, information, accompagnement
Maladies chroniques : êtes-vous concerné ?Par Marion Berthon le 07/12/2020
