
Infertilité
Dépression et infertilité : comment faire pour tomber enceinte ?Par Marion Berthon le 03/04/2025
Revue par le Pr Cédric Schweitzer, Ophtalmologiste
Mise à jour le 12/12/2023
Une lentille intra-oculaire, ou implant oculaire, est une lentille localisée à l’intérieur de l’œil, pouvant soit remplacer le cristallin, soit être placée en avant ou en arrière de l’iris. Le but est ainsi d’éviter le port de lunettes. En général, l’implant fait suite à une chirurgie de la cataracte lors de laquelle le cristallin naturel a été extrait. L’idée est de focaliser les rayons lumineux sur la rétine afin de donner une vision nette.
Ces implants ont pour objectif de rester toute la vie à l’intérieur de l’œil et ne demandent pas de soins particuliers. Ils peuvent être en hydrogel, acrylique, silicone ou plexiglas. Au décours de la chirurgie de la cataracte, la plupart des troubles de la vision peuvent être traités : l’hypermétropie, la myopie et l’astigmatisme. Parfois certains systèmes optiques présents dans les implants permettent aussi d’améliorer la presbytie dans les conditions définies par le chirurgien ophtalmologiste. C’est le cas notamment des lentilles multifocales, c’est-à-dire traitant plusieurs pathologies à la fois, comme l’association d'hypermétropie et presbytie par exemple. Actuellement, la majorité des défauts peuvent être corrigés grâce au laser, mais l’implant oculaire reste une alternative très efficace lorsque le cristallin est opacifié (cataracte) ou lorsque ce défaut visuel est trop important pour le laser.
La pose d’un implant oculaire est quasi-systématique au décours d’une chirurgie de la cataracte ou d'une chirurgie du cristallin dans le cadre d’une chirurgie réfractive.
Un deuxième avis permet donc :
Mais aussi toutes les questions spécifiques que vous vous posez.
Le spécialiste de la pose d'implant oculaire à consulter est un ophtalmologue qui évaluera la nécessité de l’opération et fera le choix du bon matériau de l’implant.
Les implants oculaires sont indiqués lors d’une chirurgie réfractive dans les cas où un défaut trop important de l’œil a été diagnostiqué et qu’il existe une contre-indication à la réalisation d’une chirurgie réfractive. En outre, il est quasi-systématiquement posé au décours d’une chirurgie de la cataracte.
Des mesures précises de votre œil sont effectuées par votre ophtalmologue afin de vous proposer l’implant le plus adapté aux caractéristiques de votre œil et d’optimiser le résultat réfractif postopératoire.
Par ailleurs, le choix du matériau est aussi fait en fonction des caractéristiques de votre œil et des conditions opératoires. Le biomatériau de l’implant et sa position dans l’œil déterminent le respect des tissus intraoculaires en postopératoire et la stabilité du résultat visuel et réfractif sur le long terme.
L’opération se déroule majoritairement sous anesthésie locale (gouttes d’anesthésiant ou anesthésie péri-oculaire) et en ambulatoire.
La chirurgie est réalisée au microscope et consiste à réaliser une incision au niveau de la cornée de 2 à 3 millimètres, ouvrir la capsule du cristallin, enlever le cristallin opacifié (cataracte) par des ultrasons (phacoémulsification), aspirer les fragments cristalliniens et insérer l’implant intraoculaire dans la position prévue par le chirurgien et généralement dans le sac capsulaire pour une plus grande stabilité postopératoire.
En postopératoire, des collyres antibiotiques et anti-inflammatoires sont prescrits et une coque protectrice est la plupart du temps recommandée la nuit pendant quelques jours.
À la suite de l’intervention, la vision peut être légèrement floutée et celle-ci ne s’accompagne pas de douleur en général. Les risques dus à une telle opération sont donc un œdème de la cornée (gonflement pathologique), les inflammations, le déplacement de l’implant, les hémorragies, le décollement de la rétine ou les infections. Cependant, ces complications restent extrêmement rares.
On peut également observer des effets secondaires, qui ne signifient ni que l’opération a mal marché, ni que cela mènera à une complication. Ceux-ci peuvent aller d’une vision un peu floue pendant quelques jours comme citée précédemment, à un œil devenant rouge, une petite douleur, mais très rare, ou à une gêne comme si un corps étranger était à l’intérieur de l’œil. Une sécheresse oculaire peut également apparaître suite à l’intervention.
On peut également citer une tendance à l’éblouissement, une réduction de l’acuité visuelle (capacité de discerner un petit objet, situé le plus loin possible), une gêne à la vision nocturne, une vision dédoublée ou un abaissement de la paupière supérieure. Un autre risque rare de cette opération est parfois une altération progressive de la cornée par l’implant lorsqu’il est posé en avant de l’iris notamment ou bien un déplacement secondaire de l’implant soit spontanément (contexte de pathologies zonulaires telles que le syndrome exfoliatif ou d’instabilité zonulaire postopératoire), soit à la suite de traumatisme.

Ophtalmologiste
CHU Bordeaux - Hôpital Pellegrin
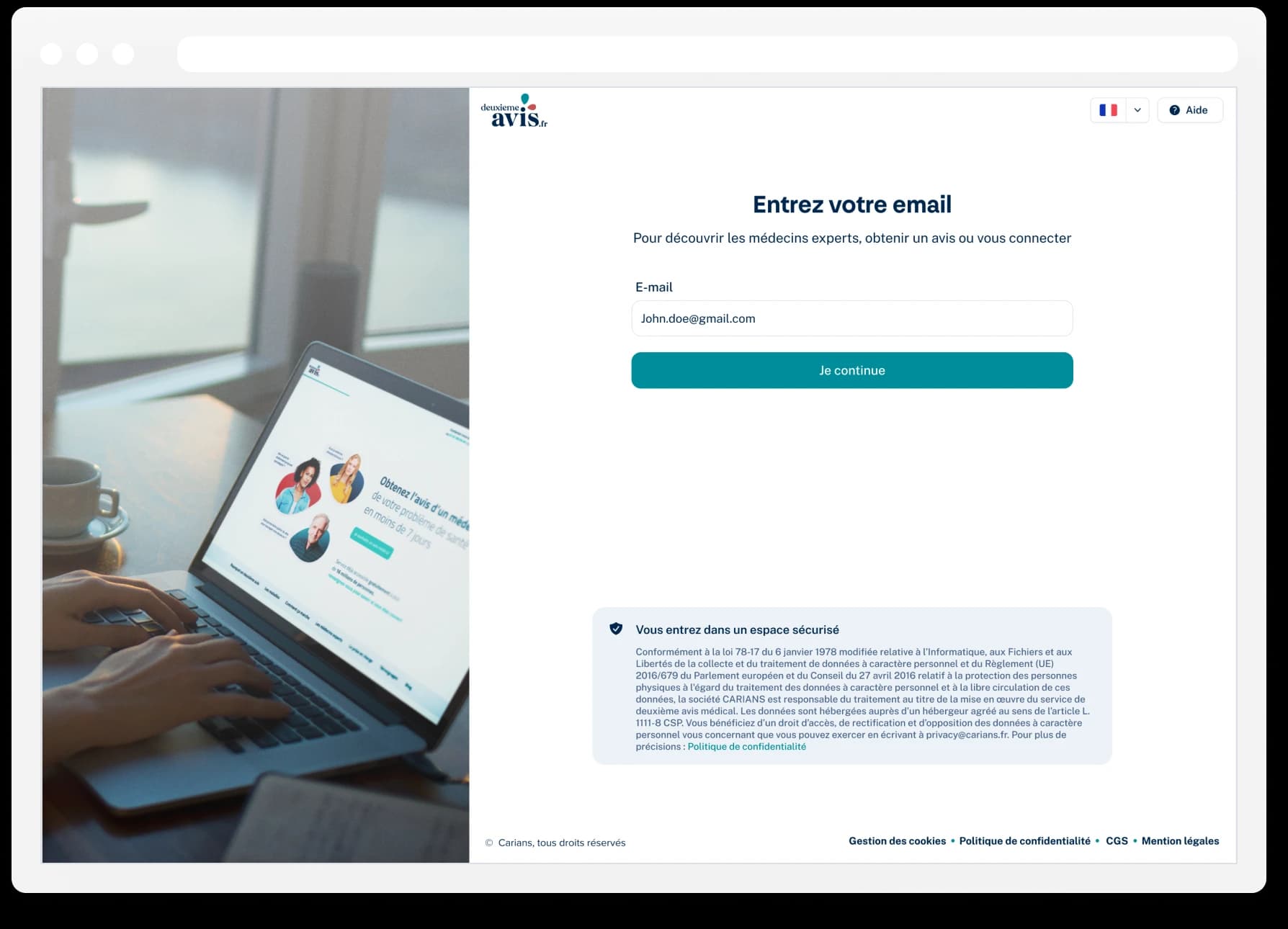

Infertilité
Dépression et infertilité : comment faire pour tomber enceinte ?Par Marion Berthon le 03/04/2025


