
Relecture d'imagerie médicale
Qu'est-ce qu'une IRM cérébrale anormale ?Par Pascaline Olivier le 24/03/2025
La maladie de Rendu Osler Weber est une pathologie génétique, touchant les enfants comme les adultes. On estime que cette maladie vasculaire héréditaire touche environ 1 nouveau-né sur 6 000. La La maladie de Rendu Osler Weber entraîne une dérégulation vasculaire à l’origine d’une hyper angiogenèse, croissance des nouveaux vaisseaux sanguins pathologiquement augmentés. Cela engendre donc des hémorragies, soit viscérales (touchant les organes internes), soit au niveau du nez, appelées épistaxis. Plusieurs gènes, comme le gène ACVRL-1, SMAD 4, l’endoglobine, sont à l’origine de la maladie. Un suivi annuel est nécessaire pour les sujets atteints de la maladie de Rendu Osler Weber.
La maladie de Rendu Osler Weber étant une anomalie génétique dominante, les parents ont un risque de 50 % de la transmettre à leur enfant s’ils sont atteints d’une des mutations.
La maladie de Rendu Osler est une pathologie lourde, pouvant mener à de graves complications. Un deuxième avis permet donc d’améliorer le diagnostic, sa précocité, ainsi que la connaissance de la pathologie. En outre, il permet d’anticiper les complications, donc de les éviter et de mieux les prendre en charge. La morbidité liée aux malformations viscérales, quel que soit l’organe, peut donc être évitée grâce à un deuxième avis. La qualité de vie des patients s’en trouve donc améliorée, et les complications beaucoup moins graves. Le pronostic des patients atteints de la maladie de Rendu Osler est donc fortement amélioré par un deuxième avis.
Mais aussi toutes les questions spécifiques que vous vous posez.
En fonction des complications et du lieu des malformations artério-veineuses, les professionnels de santé à consulter peuvent être :
Les principaux symptômes de la maladie de Rendu Osler sont tout d’abord :
Les malformations artério-veineuses peuvent entraîner des complications, car elles provoquent des shunts (déviation de la circulation sanguine, d'où résulte un mélange des sangs artériel et veineux). Les malformations artério-veineuses hépatiques (au niveau du foie), peuvent être à l’origine de nécrose biliaire (inflammation des cellules de la vésicule biliaire). Les malformations artério-veineuses pulmonaires peuvent être uniques ou multiples. Normalement, le sang veineux non oxygéné est amené dans les poumons via les artères pulmonaires. Elles communiquent avec les capillaires pulmonaires grâce auxquels l’oxygénation du sang se fait. Une fois oxygéné, le sang repart dans les veines pulmonaires, puis le coeur gauche pour alimenter l’aorte en sang oxygéné. En cas de malformation artério-veineuse pulmonaire, les capillaires pulmonaires sont anormalement remplacés par un sac anévrismal. Aucun échange gazeux ne se fait dans le sac. Ceci peut entraîner une fatigue à l’effort par désaturation (le sang n’est plus assez oxygéné), des saignements par rupture du sac ( hémothorax ou hémoptysie), des embols (le sang caillote dans le sac anévrismal et part dans la circulation générale pouvant provoquer AVC ou abcès cérébraux). La désaturation chronique entraîne une déformation des bouts des doigts “en baguette de tambour”.
Des symptômes digestifs et neurologiques peuvent également être retrouvés comme des diarrhées, du sang dans les selles, des déficits moteurs ou sensitifs, des pertes de connaissance, des crises d’épilepsie ou encore des céphalées (migraines).
Le diagnostic de la maladie de Rendu Osler est établi grâce aux critères de Curaçao. Si au moins trois de ces symptômes sont présents, le diagnostic de la pathologie peut être posé. Si deux des symptômes sont présents, la maladie de Rendu Osler peut être suspectée. Chez les adultes, le diagnostic repose également sur un examen clinique fait par un ORL (oto rhino laryngologue) et sur une nasofibroscopie, qui permet de mettre en évidence les lésions des muqueuses. Des examens d’imagerie de dépistage sont alors prescrits : l’échographie cardiaque à la recherche d’un shunt d’origine pulmonaire, un scanner thoracique sans injection, une échographie et un doppler hépatique (chez l’adulte), et une imagerie IRM cérébrale et médullaire.
Le traitement des épistaxis (saignements de nez) est un traitement symptomatique qui vise à éviter la dessiccation muqueuse (humidifications quotidiennes …). Un traitement de type thrombostatique, à base d’antiagrégant plaquettaire, est également instauré. Si les épistaxis persistent, une injection de colles biologiques ou de produits sclérosants peut être proposée, voire un traitement chirurgical en cas de saignement de nez réfractaire aux traitements cités précédemment.
Afin de contrer l’anémie, du fer par voie orale ou en injection, doit être administré quotidiennement.
Le traitement repose sur la prise en charge des complications comme le traitement de l’insuffisance cardiaque (provoquée par les shunts notamment hépatiques), de l’arythmie, de l’hypertension portale ou de la cholangite ischémique.
Le traitement des malformations pulmonaires et cérébrales est pris en charge en radiologie interventionnelle. Le radiologue thoracique et le neuroradioloque prennent connaissance du dossier d’imagerie, et jugent de la faisabilité ou non d’un traitement endovasculaire des malformations, afin de prévenir les complications hémorragiques et systémiques. C’est ce que l’on appelle une embolisation, le plus souvent par dépôt de coils (petite bobine) dans le vaisseau malade : c’est ce que l’on appelle de la radiologie interventionnelle, réalisée par un radiologue spécialisé.
Des traitements anti-angiogéniques, qui seraient des traitements de fond, sont en cours d’étude actuellement. Dans certains cas très lourds, une transplantation hépatique peut être envisagée.
Mise à jour le 25/07/2023 Revue par le Docteur Delphine Gamondès
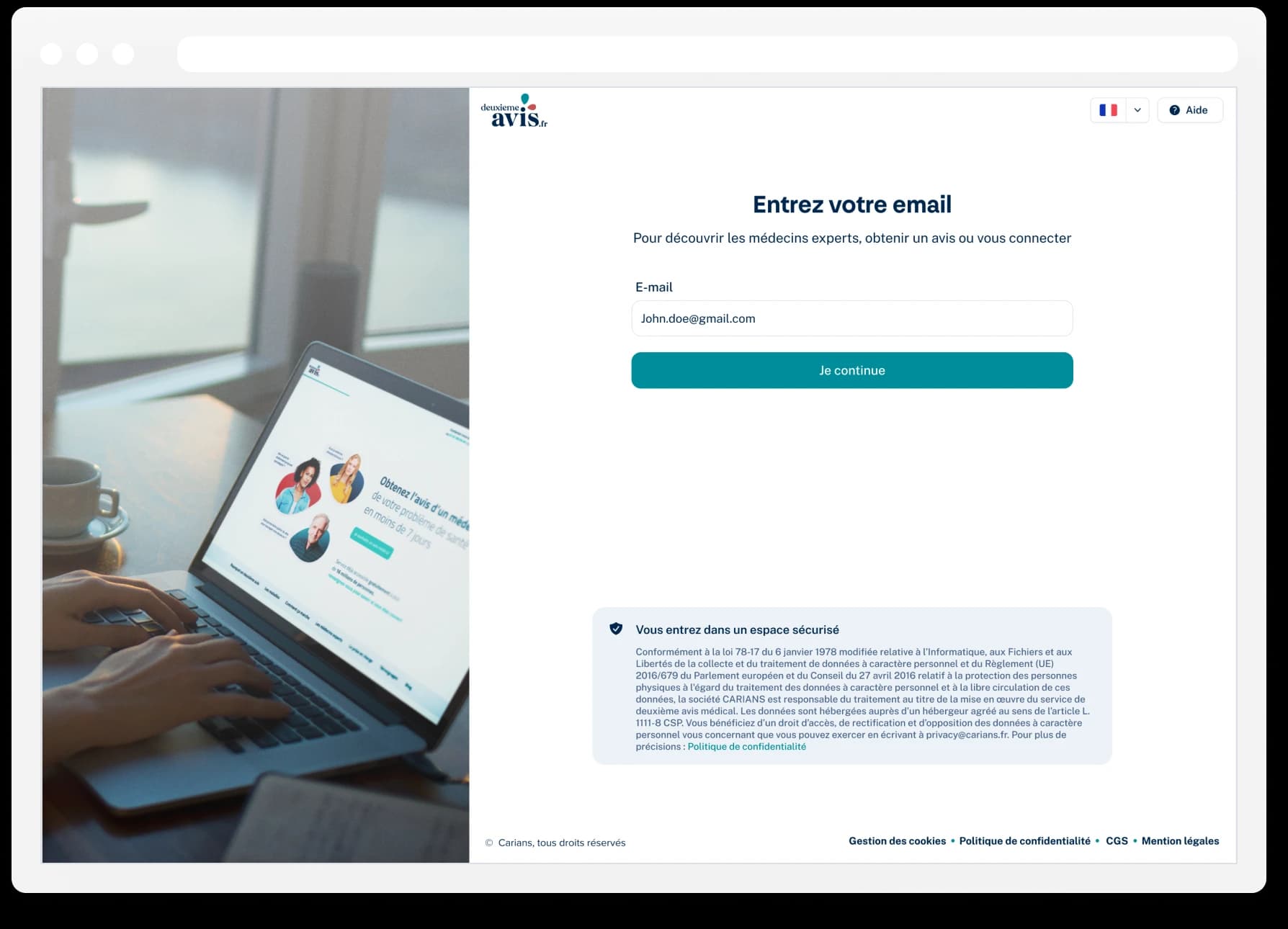

Relecture d'imagerie médicale
Qu'est-ce qu'une IRM cérébrale anormale ?Par Pascaline Olivier le 24/03/2025


Orientation, information, accompagnement
Maladies chroniques : êtes-vous concerné ?Par Marion Berthon le 07/12/2020
