
Infertilité
Dépression et infertilité : comment faire pour tomber enceinte ?Par Marion Berthon le 03/04/2025
Revue par le Pr Frédéric Bretagnol, Chirurgien viscéral et digestif
Mise à jour le 30/07/2021
Il existe plusieurs intérêts à consulter pour un deuxième avis dans le cas d'une éventration abdominale. Dans un premier temps, le spécialiste aura pour rôle de confirmer le diagnostic d’éventration et d’écarter les autres diagnostics différentiels. Dans cette logique, il pourra, en cas de doute sur le diagnostic, orienter le patient vers la réalisation d’une imagerie (scanner ou échographie). De plus, un deuxième avis avec un spécialiste de l'éventration permet de mieux comprendre comment se traite une éventration abdominale et de connaître l’ensemble des possibilités thérapeutiques et ce qu’on peut en attendre. Le spécialiste indiquera au patient le traitement le plus adapté, et le plus efficace pour soigner son éventration. Du fait du caractère potentiellement récidivant d’une éventration, le spécialiste pourra intervenir tout au long de la prise en charge de cette maladie et tout particulièrement en cas de récidive. Enfin, un deuxième avis permettra de rassurer le patient vis-à-vis d’une éventuelle prise en charge chirurgicale si celle-ci est appréhendée.
Mais aussi toutes les questions spécifiques que vous vous posez.
Les spécialistes de l'éventration abdominale à consulter dans le cadre d’un deuxième avis sont le gastro-entérologue ou le chirurgien digestif.
Les éventrations sont localisées sur d’anciennes cicatrices abdominales et, à ce titre peuvent survenir n’importe où sur l’abdomen. Comme les hernies, elles se présentent comme des tuméfactions le plus souvent indolores, bien réductibles et augmentant de volume en cas d’efforts de toux ou de défécation.
Ces éventrations contiennent du petit ou du gros intestin parfois les deux en même temps. Leur taille varie. Elles peuvent devenir symptomatiques, c’est-à-dire douloureuses avec une sensation de gêne abdominale, de météorisme abdominal et de constipation. En cas de volume important, des douleurs dorsales voire une gêne respiratoire peuvent survenir.
Cette éventration peut se compliquer, et la complication la plus redoutée est l’étranglement. Il s’agit d’une complication grave et c’est une urgence chirurgicale. Une partie de l’intestin est bloquée dans le sac herniaire et ne peut plus être réductible, c’est-à-dire ne peut plus rentrer dans l’abdomen. La tuméfaction abdominale est alors brutalement douloureuse, non réductible et non impulsive à la toux. Le patient présente alors une occlusion aiguë avec douleurs abdominales intenses, vomissements et arrêt du transit (ne peut plus émettre des gaz). En l’absence de prise en charge, cela évolue vers l’ischémie puis la nécrose du segment intestinal coincé.
Le diagnostic de l’éventration abdominale est clinique, c’est-à-dire qu’il se fait lors d’une consultation chez le médecin. La constatation d’une tuméfaction indolore en regard d’une cicatrice qui augmente lors des effets de toux et disparaît en position allongée signe le diagnostic de l’éventration.
Dans certains cas où il y a un doute sur le diagnostic, des examens complémentaires peuvent être utiles pour confirmer l’éventration. Les deux examens utiles dans ce cas sont l’échographie qui, via l’utilisation d’ultrasons, permet de visualiser l’éventration et le scanner abdominal pariétal qui lui, via l’utilisation de rayons X, permet d’obtenir des coupes de l’abdomen en 3D et donc d’observer également cette éventration.
Il existe des diagnostics différentiels, c’est-à-dire des diagnostics à ne pas confondre avec une éventration :
Ces diagnostics sont cependant réfutés suite à l’entretien avec le médecin et avec si besoin les examens d’imagerie.
Il s’agit d’un problème mécanique donc il n’existe pas de traitement médicamenteux si ce n’est pour soulager et calmer les douleurs induites. Dans la grande majorité des cas, le traitement de choix est la chirurgie.
L’utilisation de ceintures de contention abdominale peut être proposée, mais ce moyen ne représente pas une solution définitive, car cela ne peut pas corriger le défaut de cicatrisation et faire régresser l’éventration. Elles peuvent être cependant bénéfiques en limitant le volume et la gêne engendrée notamment lors des efforts physiques.
La chirurgie est la seule façon d'obtenir une correction des désordres anatomiques en supprimant le sac péritonéal et en fermant l'orifice musculaire. Faut-il opérer toutes les éventrations ? Non. Celles qui sont de petite taille, de volume stable dans le temps, peu ou pas gênantes ne nécessitent qu'une surveillance. En revanche, une intervention est souhaitable lorsqu'elles sont gênantes et douloureuses et ce d’autant plus chez le patient jeune. La chirurgie consiste à renforcer les muscles abdominaux au niveau du passage de l’éventration. Ce renforcement est possible soit grâce à une suture des muscles pour fermer l’orifice d'éventration, soit par la mise en place d’une prothèse synthétique, qu’on appelle “une plaque” pour renforcer la zone fragile au niveau de la cicatrice. Il existe deux techniques chirurgicales principales même si l’objectif reste le même à savoir réduire le sac d’éventration et fermer l’orifice pariétal. On peut donc soit réaliser une raphie simple des muscles à savoir une simple suture avec du fil, soit interposer une prothèse (technique la plus utilisée actuellement). Cette prothèse est placée soit dans la paroi abdominale (le plus souvent), soit directement dans la cavité abdominale au contact des intestins, mais il faut utiliser une prothèse particulière dite biologique avec une face non-nocive pour les intestins. Il existe deux voies d’abord, soit la voie classique par une reprise de l’incision cutanée, soit par cœlioscopie (chirurgie mini-invasive). Le choix des techniques dépendra de l’expérience du chirurgien. Le seul point consensuel est l’utilisation d’un renfort prothétique pour diminuer le risque de récidive.
Les complications postopératoires peuvent survenir, mais elles sont rares. Le risque le plus important est le risque infectieux, c’est-à-dire d’infection du matériel étranger prothétique mis en place. Généralement, ce risque est peu fréquent (1 %) et survient en postopératoire immédiat. En cas d’infection, il faut alors dans la plupart des cas réopérer pour retirer la prothèse tout en associant la prise d’antibiotiques per os. Ce risque infectieux est plus fréquent chez des patients obèses et diabétiques.
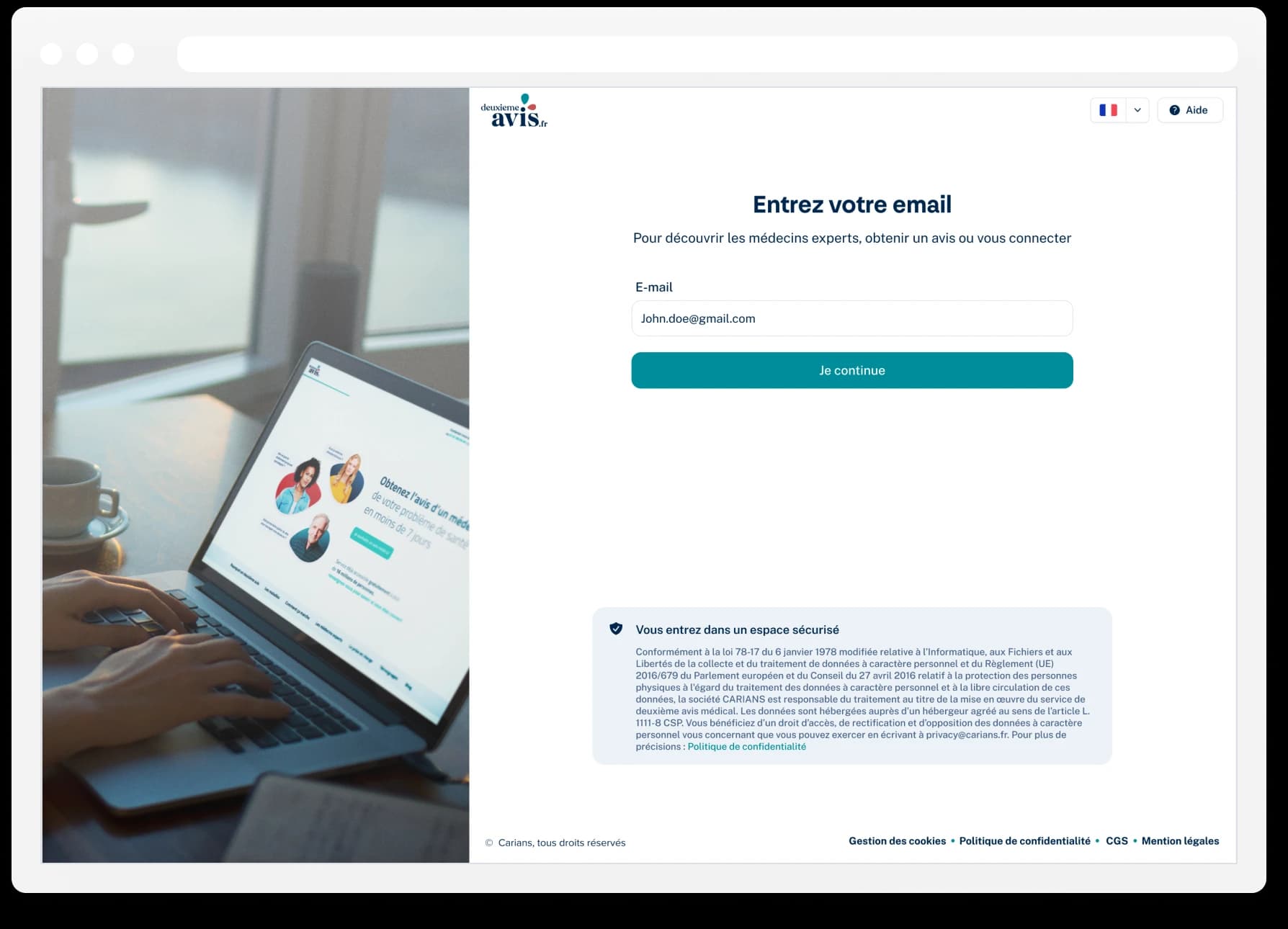

Infertilité
Dépression et infertilité : comment faire pour tomber enceinte ?Par Marion Berthon le 03/04/2025


