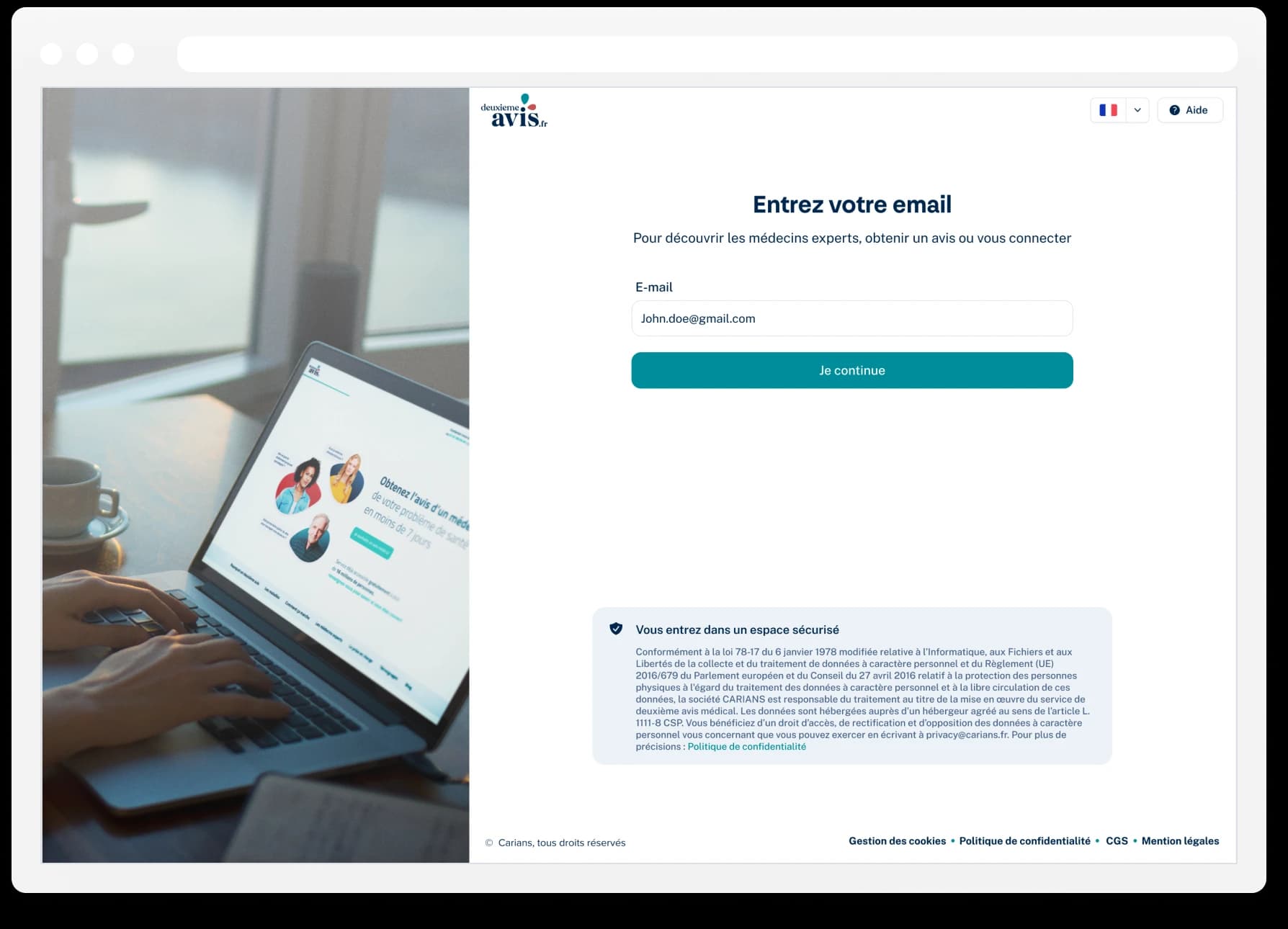L’algie vasculaire de la face (ou cluster headache en anglais) est une douleur localisée au niveau de la boîte crânienne, qui survient sans raison apparente (une céphalée primaire). Elle se traduit par des crises douloureuses d’une extrême violence, souvent concentrées sur un côté de la face. Les crises durent de 15 minutes à 3 heures et peuvent survenir plusieurs fois par jour. Cette pathologie touche surtout des sujets jeunes (entre 20 et 50 ans) et masculins. Elle a la particularité de survenir de façon régulière et presque cyclique, voire parfois à horaires réguliers.
Chez la plupart des patients, ces crises sont épisodiques. Les périodes de crise alternent alors avec des périodes de rémission, de durée variable. Toutefois, on estime qu’environ 10% des patients développent une forme chronique de la maladie. Ces patients ont peu de répit entre les crises et leurs périodes de rémissions durent moins d’un mois. Le retentissement de la maladie sur leur vie est donc très lourd. Il arrive aussi qu’ils développent une résistance à tout type de traitement médicamenteux. On parle dans ce cas de « cluster headache chronique réfractaire » ou CHCR. Ces cas particuliers sont orientés vers les traitements par neurostimulation. Ce sont ces traitements spécifiques que nous détaillons dans cette fiche.
En effet, depuis une dizaine d’années, des techniques de neurostimulation ont été développées. Elles permettent, au moyen d’électrodes implantées dans le cerveau, de soulager considérablement les patients souffrant de ce type particulier de céphalées. Ces techniques, plus ou moins invasives, impliquent une sélection drastique des candidats: ils doivent souffrir de la maladie de façon chro-nique depuis au moins 2 ans, résister à tout traitement médicamenteux, et avoir au moins 2 crises par jour.
Deux procédés principaux existent: la stimulation profonde du cerveau (SPC) et la stimulation du nerf grand occipital.
La stimulation profonde du cerveau consiste à implanter une électrode dans l’hypothalamus, qui fait partie du système nerveux central. Cette méthode présente une efficacité considérable: dans près de 60% des cas, elle permet de réduire de moitié le nombre de crises. Il s’agit néanmoins d’une technique invasive et non dénuée de risques. Les spécialistes estiment qu’il y a environ 4% de chance de déclencher une hémorragie cérébrale.
La stimulation du nerf grand occipital (SNO) est une technique moins invasive que la première et présentant moins d’effets indésirables. Elle consiste à stimuler (par de faibles impulsions élec-triques) le nerf grand occipital, qui fait partie du système nerveux périphérique. Pour cela, le chirurgien implante deux électrodes dans le haut de la nuque. Ces électrodes sont ensuite reliées à un générateur d’impulsions, implanté sous la peau, dans la région de l’abdomen. Une fois en fonctionnement, la stimulation occipitale agit comme un traitement de fond de l’AVF en diminuant la fréquence des crises ou leur intensité.
Une fois les électrodes implantées, il faut ensuite régler les paramètres de stimulation, pour que les électrodes agissent de façon optimale. Cela demande parfois un certain temps avant de trouver la bonne mise au point.
D’autres approches de neurostimulation sont en cours d’essai, comme la stimulation du ganglion sphénopalatin (SGSP), qui consiste à implanter un microstimulateur en dessous de la pommette.
Ces nouvelles approches visent toutes à prévenir ou à faire avorter les crises d’AVF chronique. Mais aucune donnée n’est véritablement disponible à ce jour évaluer les résultats à long terme. Ainsi, même si la stimulation du ganglion sphénopalatin est prometteuse, elle nécessite encore de prouver son efficacité.